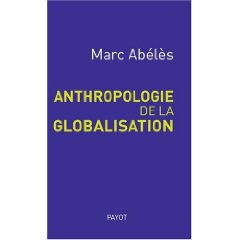
Après avoir mené plusieurs travaux empiriques dans des lieux concernés par la globalisation (Commission européenne, Silicon Valley, etc.), Marc Abélès propose dans ce nouvel ouvrage une réflexion générale et percutante sur l’intérêt de la démarche anthropologique pour comprendre la globalisation. Il réaffirme sa vision de l’anthropologie et précise notamment pourquoi la dichotomie entre sociétés du lointain et sociétés du proche lui semble dépassée. L’importance des phénomènes transnationaux qui caractérise la globalisation amène l’anthropologie à rendre intelligible les liens qui se tissent entre les différentes parties du monde.
Il nourrit son propos d’un riche itinéraire de lectures critiques allant des classiques de l’anthropologie aux « postmodernes américains » pour mieux donner à voir ce qui façonne sa vision de la discipline. Il discute rapidement l’usage des termes, préférant le mot « globalisation » à celui de mondialisation. Il rappelle que nous avons déjà assisté à d’autres époques à des périodes de mondialisation et le terme de globalisation vient souligner la spécificité d’une époque qui se caractérise par un niveau d’intégration et d’interconnexion inédit. Cela se traduit, selon lui, par l’émergence de modes de vie spécifiques pour les individus et par l’apparition d’institutions sociales comme les ONG ou les organisations internationales.
A partir de ce constat, il propose cinq chapitres qui reprennent les grands concepts de la discipline en y apportant son regard critique appuyés par la mise en valeur de travaux apportant justement un autre regard sur l’activité humaine sortant définitivement l’anthropologie de l’exotisme.
Il revisite le concept de culture qui a forgé la discipline. Il fait remarquer que ce sont d’abord les économistes qui nous ont fait prendre conscience de la globalisation en décrivant la transnationalisation des capitaux. Ce phénomène ne se réduit pas au capital. Penser en termes de flux remet au centre l’échange – notion centrale de la discipline – dans l’activité humaine. Les flux de marchandises, d’hommes et de femmes, d’idées qui matérialisent la globalisation ne se limitent pas à des formes culturelles singulières. Ils déterminent de manière centrale la question du politique. En effet, la production et le contrôle de ces flux tout autant humains, marchands, idéologiques que religieux déterminent le champ de l’action publique. Cela amène inévitablement à penser la transformation de l’Etat.
Les rapports sociaux émergents induisent aussi de nouveaux lieux du politique que les anthropologues se doivent d’observer pour comprendre l’évolution des sociétés. En effet, la globalisation trouve son expression institutionnelle à travers la montée en puissance des organisations internationales (l’UE, le FMI, l’ONU) et de nouveaux acteurs (ONG, fondations, etc.).
La définition qu’il propose de la globalisation – « les gens et les lieux de par le monde sont aujourd’hui extensivement et densément connectés les uns aux autres en raison des flux transnationaux croissants de capitaux, de marchandises, d’informations, d’idées et d’êtres humains » (p. 17) – est une invitation à une posture d’observation dans laquelle la démarche qualitative de l’anthropologie, avec ses outils spécifiques, offre un regard singulier et percutant pour comprendre le monde dans lequel nous vivons.
Cette définition empirique consiste à décrire de manière fine ce qui se joue dans ces relations sociales. Abélès rappelle un premier point important, la globalisation ne va pas dans le sens de l’absence de territoire, il y a une géographie de la richesse et cela n’est pas incompatible avec des Etats forts et avec l’existence de frontières difficiles à passer voire impossibles à franchir pour certains. Cependant, il est totalement faux de réduire la globalisation à une domination du Nord sur le Sud.
De récents travaux montrent que des espaces politiques globalisés qui ont la réputation d’être en marge sont au contraire au centre de l’organisation de ces flux mondiaux. Les marges ne signifient pas marginalité (J. Roitman, Pandolfi, etc.) mais permettent de penser en creux le fonctionnement global du monde d’aujourd’hui.
Abélès récuse la posture qui consisterait uniquement à se prononcer sur la dangerosité ou les vertus positives de la mondialisation. Le questionnement est ailleurs. L’auteur renvoie dos à dos, les partisans de la mondialisation qui voient en elle l’émergence d’un monde marqué par la fin de l’Etat nation. Il rejette tout autant la rhétorique de la dénonciation voyant dans la globalisation soit uniquement une affirmation des grandes puissances soit exclusivement un appauvrissement du Sud.
Pour décrire ce monde en gestation, l’anthropologie doit s’appuyer sur ce qui a fait le cœur et la force de sa démarche : « décrire ce qui est ». Elle ne se réduit pas à la l’analyse d’un monde ou d’une culture qui meurt mais se doit de décrypter ce qui est en train de naître. Pour cela il faut suivre les acteurs et sortir du local, de l’identité pour aller vers l’activité humaine et suivre ces flux complexes pour comprendre des interdépendances qui bouleversent complètement la structure familiale, les réseaux de solidarité. Il rappelle les travaux précurseurs d’Eric Wolf qui montre que cela fait bien longtemps que les autochtones ne sont plus des autochtones.
Abélès part ainsi de la critique de la notion classique de culture qui ne peut être réduite à un catalogue objectif de traits distinctifs et stables d’un groupe déterminé afin d’être attentif à ce qui est en train de changer sous nos yeux.
Cette posture a des implications méthodologiques majeures. Dans cette perspective, « l’anthropologue n’étudie pas les villages mais dans les villages » (C. Geertz) (p. 70) et le terrain n’est qu’un dispositif méthodologique : étudier le micro ne prend son sens que dans un dispositif plus vaste. L’anthropologue se fixe comme exigence de rendre compte de l’intimité de relation au niveau local mais en ayant toujours le souci de mettre en évidence les relations d’échelle entre le local et d’autres niveaux macro. Cela implique notamment aujourd’hui pour l’anthropologue de varier les échelles d’observation pour appréhender les phénomènes en vigueur.
Les anthropologues doivent ainsi penser le changement et dans l’idée de changement la question de l’altérité se remodèle. La question de savoir, « où est l’autre », « où est l’étrange », doit se repenser dans l’idée qu’il y a une modification des frontières. Il souligne à ce titre l’apport de Georges Balandier pour la prise en compte des dynamiques sociales mais souligne aussi l’importance des anthropologues américains qui ont remis en cause la question du rapport au temps et souligné l’importance de l’écriture face au dogme du primat du terrain. Les travaux de Gupta et Ferguson ont eu notamment le mérite de déconstruire le mythe du terrain et de l’authentique.
Dans ce contexte, l’idée que l’appréhension des cultures se fait dans un monde globalisé va à l’encontre d’une tradition anthropologique exotique, dans son rapport à l’espace et au temps.
Abélès pense qu’une ethnographie du global est possible à partir du moment où l’on prend en compte trois éléments complémentaires : l’influence des forces externes sur la vie locale, les connexions existantes entre différents lieux, les représentations qui façonnent le quotidien et qui s’alimentent au global comme le suggère d’ailleurs l’anthropologue Burawoy (p. 94).
Il rappelle que cette approche trouve ses racines dans la démarche de l’Ecole de Manchester et de celle de Chicago. Pour saisir la situation de la population immigrée polonaise dans la ville de Chicago, Thomas et Znaniecki portent une attention aux correspondances d’immigrés et font plusieurs voyages en Pologne. Il souligne aussi l’intérêt de la démarche novatrice d’Arjun Appadurai et de ses notions de flux et « d’ethnoscape » amenant à repenser les diasporas. Cette modification du regard n’a pas que des implications méthodologiques et théoriques, elle a des conséquences inévitables sur l’organisation de notre discipline et pose notamment la question de la pertinence des aires culturelles.
L’auteur en vient au cœur de la réflexion qui a jalonné ses travaux concernant le politique. Il regrette à ce titre que le débat sur la globalisation porte essentiellement sur le déclin ou le renforcement de l’Etat et oppose schématiquement souverainistes et globalistes. L’anthropologie, ayant montré la diversité de systèmes politiques qui ne se réfèrent pas forcément à l’Etat, a un atout pour décrire ce qui est en train d’émerger. Abélès rappelle que l’Etat est une variété d’exercice du pouvoir comme une autre dans l’histoire des sociétés humaines.
Il plaide ainsi pour penser les nouvelles formes de gouvernementalité non plus en terme de plus ou de moins d’Etat, mais plutôt en terme de « déplacement » de souveraineté (les réseaux transnationaux en étant une illustration). Il rappelle par ailleurs que l’Etat demeure une réalité prégnante et qu’il est donc temps de penser les différents exercices de la souveraineté.
L’anthropologie a contribué à désacraliser l’Etat qui n’est plus seulement considéré comme une entité juridique, mais comme le reflet de l’activité humaine. A ce titre, Abélès souligne sa dette envers Michel Foucault dans sa manière d’appréhender l’exercice du pouvoir (p. 129) mais aussi à Georges Bataille. Il met en exergue l’importance de travaux récents d’anthropologues comme Ernest Gellner ou Benedict Anderson sur la Nation ou encore de Michael Herzfeld sur le phénomène bureaucratique qui ont contribué à ne pas essentialiser le politique et l’Etat. L’Etat produit plusieurs effets précis : « il individualise et sérialise les sujets ; en second lieu, il code et codifie avec ses instruments statistiques et ses procédures réglementaires et légales, enfin il spatialise, engendre des délimitations et des frontières et ne cesse d’entretenir l’opposition entre l’intérieur et l’extérieur, l’autochtone et l’étranger » (p. 141).
Dans la situation actuelle, les frontières ne s’abolissent pas, elles changent de fonctions dans un nouveau contexte. Le transnationalisme conditionne également les relations de pouvoir. C’est alors qu’intervient le travail de l’anthropologue pour mettre à jour que, sous l’ordre institutionnel, il y a des affinités sous-jacentes, des rapprochements souterrains qui n’apparaissent pas au grand jour. En travaillant sur des fissures, des plis, l’anthropologie donne à voir le champ du pouvoir de la globalisation.
Cela peut se faire notamment dans les lieux du pouvoir qui expriment le mieux la globalisation : les organisations internationales. Dans celles-ci, la question du pouvoir est toujours présente car une institution qui doit penser sans cesse une ouverture plus grande doit également penser à des formes d’uniformisation, au choix d’une sémantique prenant un relief tout à fait particulier. Toutes ces représentations et ces pratiques façonnent un pouvoir singulier. L’anthropologie a donc vocation à explorer ces lieux de pouvoir et de contre-pouvoir transnationaux. Il faut penser, selon l’auteur, la réorganisation des pouvoirs et la montée en puissance du transnational car c’est la représentation du politique qui est en train de changer : « le déplacement du politique est déterminé par une redéfinition globale du sens et des objectifs de l’action politique » (p. 152).
Ainsi, le déplacement du lieu du politique n’est pas une cause mais un effet du changement de notre représentation du politique et les institutions internationales s’attachent à la mise en ordre impossible du monde, d’une harmonie introuvable. On pourrait objecter à Abélès une vision trop universalisante que ne partage pas forcément toutes les populations concernées par la globalisation.
Il s’interroge ensuite sur la relation à établir entre violence et globalisation constatant qu’une des conséquences de la globalisation est l’aggravation des inégalités. Il lie la question de l’accroissement de la violence dans certains pays avec l’accroissement des inégalités et pense à ce titre que « la réflexion à partir des marges s’avère indispensable » (p. 171), car la production des marges est inséparable de l’activité de gouvernement et la globalisation ne peut se résumer à une dynamique positive augmentant les flux. Elle produit de l’exclusion à grande échelle. Selon Abélès, la violence dans certains pays devient alors « structurale ». Dans certains cas, c’est l’Etat déficient qui est en cause, dans d’autres ce sont des formes d’exploitation et de souffrance sociale liées à l’exercice du pouvoir par l’Etat. Il cite de nombreux travaux d’anthropologues qui nous donnent justement un regard singulier sur ces sociétés en proposant une vision par le bas. Les réfugiés, les « sans papiers » portent les stigmates d’une intégration impossible, d’une violence co-extensive.
Il s’interroge ensuite sur l’émergence de réseaux transnationaux et l’importance prise dans le champ social par les ONG, modifiant en profondeur l’espace politique en remodelant les légitimités locales.
Marc Abélès propose ainsi sa vision de l’anthropologie. La discipline doit traiter de cette intrication de plus en plus forte entre le local et le global. Elle n’a ni la vocation à être la voix des « sans » (papiers, logements, etc.) et des marginaux ni celle de conseiller du prince.

