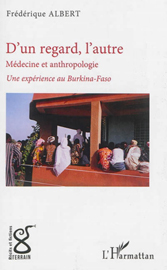
Les thèmes de la santé et de la maladie sont aujourd’hui des objets privilégiés des sciences humaines. Une discipline s’est constituée et imposée : l’anthropologie de la maladie. Elle s’est autonomisée, rompant ses liens scientifiques avec la médecine. Mais d’autres types de liens demeurent : plusieurs ethnologues ont aussi été médecins. C’est le cas d’un des pères de la discipline, Williams Rivers ou d’auteurs contemporains comme Alice Desclaux ou Didier Fassin. On peut se questionner sur la place qu’occupent de tels chercheurs sur le terrain. L’anthropologue de la santé étant celui qui observe le médecin, comment peut-on être à la fois l’un et l’autre ?
C’est une des questions auxquelles répond Frédérique Albert, médecin confirmé et ethnologue en devenir. Son livre, publié en 2015 chez l’Harmattan, porte un titre évocateur : « D’un regard, l’autre, Médecine et anthropologie ». Ce texte est un approfondissement de ses mémoires d’anthropologie de Master 1 et 2.
Le premier chapitre porte sur sa première enquête dans un dispensaire burkinabé, chez les Moses, en pays Moaga. L’auteure voulait y réaliser une ethnographie tout en dispensant quelques soins en échange de l’accueil dans le dispensaire. Dépassée par son statut de médecin, elle a été entièrement occupée par les consultations médicales. Mais, chercheuse apprentie, elle a, en ̏ Monsieur Jourdain ̋ de l’ethnographie, fait de l’observation participante sans le savoir. Elle a donc travaillé a partir de données recueillies de façon informelle.
F. Albert s’est intéressée au comportement de ses patients. Ces derniers étaient très réservés : Ils ne posaient pas de question sur leur maladie et n’exprimaient ni leur angoisse ni leur souffrance. A ce stade de la recherche, l’auteure associait ce mutisme aux rituels de passage en cours dans la société Moaga. Le silence y est exigé car ne pas protester, c’est affirmer que l’on accepte d’accéder à un nouveau statut. La maladie serait un rite de ce type. Dans ce contexte, exprimer sa souffrance entrainerait la réprobation des pairs.
Dans le second chapitre, l’auteure rend compte de sa deuxième enquête sur le même terrain. Elle est retournée au dispensaire mais cette fois sans faire de consultation. Elle s’est attachée à expliquer une observation paradoxale : les patients affirmaient l’importance de connaitre le nom de la maladie mais pourtant, ne le demandaient jamais au médecin.
Les Mooses font coexister, sans contradiction, la médecine occidentale et les pratiques traditionnelles. Pour autant, certaines maladies existant dans leur classification ne correspondent à rien dans la nosologie biomédicale. F. Albert s’est donc penchée sur le système classificatoire des Mooses. Elle a repris la typologie de Jean-Pierre Olivier de Sardan, à savoir, la distinction entre « maladies prosaïques » et « maladies non prosaïques » : Les maladies prosaïques sont courantes, leurs symptômes sont facilement identifiables. Il n’est pas nécessaire de leur trouver une étiologie car la cause n’est de toute façon pas particulièrement inquiétante. Nommer le mal suffit à « clore le sens » (p. 74) et à rassurer le malade. La guérison primant sur la cause, on fait confiance au médecin sans lui poser de questions. Les maladies non-prosaïques sont celles qui ont des symptômes inquiétants. Selon les mooses, elles sont dues à la transgression d’un interdit. Ces maladies n’ont pas de nom. Pour leur donner un sens, il faut donc leur trouver une cause. Certaines de leurs manifestations sont tues au médecin car on estime qu’elles échappent à ses compétences.
Ces représentations de la maladie et les réponses thérapeutiques qu’elles appellent engagent le groupe social dans son entier. La décision de recourir à la médecine se prend collectivement. Or, si l’on estime qu’untel est malade parce qu’il a commis une faute, on peut lui nier le droit d’aller se soigner. Être atteint d’une maladie non-prosaïque, c’est souvent être soupçonné d’une faute et donc risquer d’être rejeté.
Dans un troisième chapitre, l’auteure fait une relecture de ces deux expériences. Elle corrige ses premières analyses sur le mutisme des patients. Elle n’incrimine plus leurs représentations. Elle interprète désormais leur mutisme comme une « soumission » face à l’organisation postcoloniale du dispensaire.
Au fil du texte, l’auteure remet en cause les présupposés culturalistes qu’elle développait au début de son enquête. Elle ne pense plus que les Moses jugent inutile de recourir à un médecin pour une maladie non-prosaïque. L’opposition entre la médecine occidentale et la médecine traditionnelle n’a pas de sens dans cette société. En revanche, le catholicisme et la biomédecine condamnent la médecine traditionnelle. La peur de la réprobation par les soignants peut conduire les patients à taire certains symptômes.
L’auteure conclut son ouvrage par une analyse de son statut de chercheur. Selon elle, ses premiers choix épistémologiques étaient influencés par son double statut de médecin et d’ethnologue : « En effet, écrit-elle, je n’ai pas compris tout de suite que mes comparaisons et mes hypothèses reposaient non seulement sur des connaissances médicales mais aussi sur leur intégration dans un habitus particulier : celui où j’exerçais le rôle de médecin généraliste dans la société française » (p. 112).
A la lecture de ce livre, on éprouve souvent de la frustration. Certains points gagneraient à être davantage discutés à la lumière d’une littérature manquante dans le texte. C’est le cas par exemple des observations portant sur les étiologies et les questions de transgressions. Les analyses de Richard Pottier, relatives à la dimension axiologique des interprétations de la maladie (Pottier, 2007), auraient permis d’affiner des réflexions qui restent ici superficielles. Nombre d’analyses, manquant d’apports théoriques, souffrent de trop d’approximations. C’est le cas notamment du passage portant sur le tabou de la sexualité pendant la période d’allaitement (pp. 84-86). L’auteure donne une interprétation à cet interdit : si un deuxième enfant naît, la mère ne pourra suffisamment l’allaiter. Or, ce tabou existe également dans des sociétés où il n’y a pas de risque de malnutrition. Marc Augé a montré que ce type d’interdit est lié à la symbolique des similitudes et des contraires (Augé, 1983). Restant à des conceptions utilitaristes de l’interdit, F. Albert tombe dans le piège de la rationalisation biomédicale. La question économique, enfin, aurait nécessité d’avantage de développements. L’auteure affirme rapidement que chez les Mooses, le manque d’argent est l’obstacle principal au recours à la médecine. Aussi intéressante soit-elle, cette remarque aurait mérité d’être étayée par des données de terrain et confrontée aux autres enquêtes sur le sujet.
Mais ces quelques imprécisions n’entachent en rien la qualité du livre. Son intérêt ne réside d’ailleurs pas tant dans les analyses du rapport à la santé des Mooses que dans son approche réflexive. Lire F. Albert, c’est la suivre au long de ses pérégrinations intellectuelles parsemées de doutes et de revirements. Ses efforts permanents de remises en question marquent les étapes successives de sa réflexion sur le mutisme des patients : elle a d’abord analysé ce silence comme une conséquence des représentations moaga avant d’y voir un effet de l’organisation du dispensaire. A la lecture de ces pages, on ne peut pas ne pas penser aux « carnets » de Lucien Lévy-Bruhl où ce dernier corrigeait ses théories ethnocentriques de la « mentalité primitives » (Lévy-Bruhl, 1949). F. Albert nous rappelle ainsi que le chercheur n’est qu’un éternel apprenant.
Elle questionne également ses statuts d’ethnologue et de médecin. La position qu’elle a dû occuper l’a placée contre son gré dans une situation de domination : influencée par le cadre institutionnel, elle a participé à la coercition médicale que, par ailleurs, elle dénonce. Elle affirme qu’il est primordial de s’interroger sur ces sujets : « Le plus important, il me semble, est de savoir réduire les préjugés ethnocentriques que nous avons, qui sont eux-mêmes en lien avec notre habitus » (p. 115). C’est peut-être dans cette démarche que réside l’essentiel de tout projet anthropologique. Elle rappelle la difficulté à être à la fois l’observateur et un sujet de ces mêmes observations. « On peut être médecin et anthropologue, écrit-elle, mais probablement pas soignant et anthropologue tout à la fois » (p. 115). Au final, l’ouvrage est un document fort utile pour qui veut comprendre ce qu’est faire de l’anthropologie de la santé.

